News
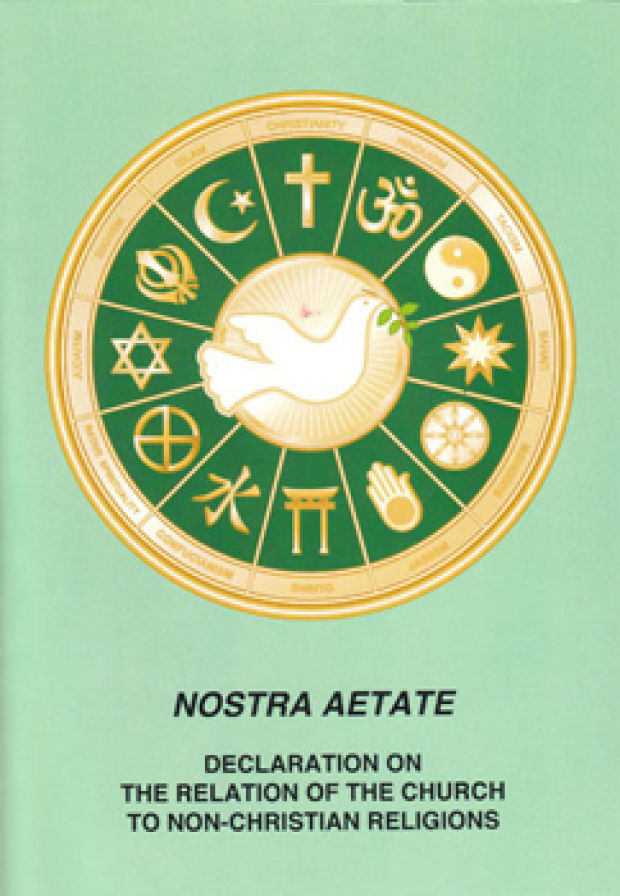
Les universités catholiques à l’heure de Nostra Aetate : soixante ans de dialogue, un avenir pour la diplomatie académique
I. De la déclaration conciliaire à la culture universitaire
Soixante ans après sa promulgation, Nostra Aetate demeure sans doute l’un des textes les plus marquants du Concile Vatican II. Publiée le 28 octobre 1965, la Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes marquait un tournant anthropologique majeur : le passage d’une théologie de la différence à une théologie de la rencontre. Elle invitait l’Église à reconnaître les semences de vérité présentes dans toutes les traditions religieuses et à s’ouvrir à un dialogue fondé sur la dignité commune de la personne humaine.
Ce texte, d’abord perçu comme une avancée spirituelle, est devenu progressivement une matrice culturelle et éducative. Car le dialogue n’est pas seulement une attitude ; il est une pédagogie, une méthode intellectuelle et un horizon de société. Nulle part cette dynamique n’a pris autant de corps que dans les universités catholiques : ces lieux où la foi se confronte à la raison, où la tradition devient culture, et où l’altérité se fait objet d’étude autant que promesse d’avenir.
L’histoire de Nostra Aetate au sein du monde académique catholique est celle d’une lente et féconde traduction : d’une parole conciliaire à une praxis universitaire, d’une exhortation spirituelle à un écosystème mondial de formation et de recherche. À l’échelle mondiale, on observe au sein de la Fédération internationale des universités catholiques combien cette intuition conciliaire demeure vivante : elle structure des campus, inspire des pédagogies et fonde un véritable langage diplomatique du savoir.
II. Cartographie mondiale d’une réception intellectuelle
Les commémorations du soixantième anniversaire, en 2025, l’ont clairement montré : Nostra Aetate est devenue un langage commun pour la quasi-totalité des universités catholiques du monde. De Washington à Nairobi, de Beyrouth à Manille, le texte conciliaire inspire programmes de recherche, cycles de conférences et projets de coopération interreligieuse.
En Europe
L’Institut Catholique de Paris a organisé deux webinaires intitulés “Nostra Aetate : 60 ans après ?”, associant théologiens, islamologues et sociologues des religions. En Allemagne, la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt a consacré son Forum Religion und Gesellschaft de 2025 à « Nostra Aetate et la refondation du dialogue islamo-chrétien ». Cet événement, mené en partenariat avec la Conférence des évêques allemands et l’Université d’al-Azhar, illustre une approche où le dialogue interreligieux est à la fois objet de recherche et exigence sociale.
En Belgique, KU Leuven a intégré la réception de Nostra Aetate dans son congrès LEST XV, consacré aux horizons du catholicisme mondial. Ces initiatives démontrent la vigueur intellectuelle d’un héritage conciliaire devenu culture académique.
Enfin, les universités pontificales romaines - en particulier la Gregorienne - ont accueilli le colloque international “Towards the Future: Re-thinking Nostra Aetate Today”, en coordination avec le Dicastère pour le dialogue interreligieux. Ce moment romain a symbolisé la convergence entre magistère, recherche et pédagogie, confirmant le rôle du Saint-Siège comme catalyseur de cette intelligence mondiale du dialogue.
En Amérique du Nord
L’Université de Georgetown maintient depuis 2015 la Nostra Aetate Lecture Series, véritable institution intellectuelle où se croisent cardinaux, rabbins et chercheurs musulmans. L’Université de Notre Dame, pour sa part, a lancé en 2025 un cycle de conférences intitulé “Nostra Aetate in Their Age and in Ours”, en partenariat avec l’Université hébraïque de Jérusalem — illustrant comment la recherche catholique devient ici instrument de réconciliation.
En Amérique latine
La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico et l’Universidad Católica del Uruguay ont organisé des symposiums réunissant représentants juifs et musulmans, tandis que l’Universidad Católica de Costa Rica célébrait l’anniversaire avec l’ambassade d’Israël. Ces initiatives soulignent combien Nostra Aetate nourrit un pluralisme enraciné dans la culture du continent.
En Afrique et au Moyen-Orient
Au Liban, Notre Dame University – Louaize (NDU) incarne l’esprit de Nostra Aetate dans un contexte de pluralisme religieux dense. L’université, qui abrite la Chaire UNESCO pour l’éducation à la paix, déploie chaque année une Interreligious Peace Week et forme ses étudiants à la coexistence par des cours explicitement inspirés du document conciliaire. Véritable laboratoire du dialogue islamo-chrétien, la NDU fait du campus un lieu d’expérimentation d’une catholicité ouverte et hospitalière, où le pluralisme devient compétence intellectuelle et projet social.
En Afrique, des institutions comme l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) ou l’Université Catholique du Congo (UCC) développent des cursus sur la coexistence religieuse, prolongeant la logique conciliaire dans des sociétés à pluralisme vécu.
III. Du texte à l’écosystème : l’esprit de Nostra Aetate dans la pédagogie contemporaine
Ce que révèle la diversité de ces célébrations, c’est que Nostra Aetate n’est plus seulement un document d’Église : c’est une culture éducative.
Dans les universités catholiques, elle inspire aujourd’hui une pédagogie de la relation :
- Une pédagogie intellectuelle, qui refuse le relativisme tout en reconnaissant la pluralité des vérités vécues ;
- Une pédagogie spirituelle, qui voit dans la rencontre de l’autre un espace de conversion intérieure ;
- Une pédagogie citoyenne, où le dialogue interreligieux devient école de paix et laboratoire d’humanité. Le colloque organisé sur ce sujet à la Christ University de Bangalore en novembre 2026 en sera une excellente illustration
Les campus catholiques se situent ainsi à l’avant-garde d’une transformation profonde de l’enseignement supérieur : ils forment non plus seulement des diplômés compétents, mais des sujets relationnels capables de comprendre les fractures du monde globalisé. Le pluralisme y est pensé non comme menace mais comme discernement.
IV. Les universités catholiques comme diplomaties de la connaissance
Si Nostra Aetate a transformé la théologie, elle a aussi transformé la géopolitique silencieuse du savoir. Les universités catholiques peuvent constituer aujourd’hui un réseau de diplomatie intellectuelle, unique par son étendue et son autorité morale. Elles peuvent prolonger, sur le terrain académique, la diplomatie du Saint-Siège : une diplomatie sans armées ni frontières, mais fondée sur la parole, la recherche et la coopération. C’est un axe fort du plan stratégique du nouveau président de la FIUC.
1. Le campus comme ambassade
Chaque université catholique, lorsqu’elle ouvre un espace d’étude comparée des religions ou accueille des étudiants d’autres traditions, agit comme ambassade intellectuelle de l’esprit de Nostra Aetate. À Washington, Beyrouth ou Manille, ces institutions rendent visible une catholicité ouverte, hospitalière, en dialogue constant avec le monde. Lors de la dernière assemblée générale de la FIUC tenue à Guadalajara, Mgr Gallagher pouvait ainsi déclarer : « every university can be something of a diplomatic mission. These networks foster not only scientific progress but also relationships grounded in mutual respect and shared goals. What better place than a university classroom to bring Christians, Muslims, Jews, Buddhists, and non-believers together? Here, students and scholars confront difference constructively, moving beyond stereotypes toward genuine mutual understanding. This lived ‘academic diplomacy’ builds trust and defuses tensions at the basic, everyday, human level. In this way, universities are not ivory towers detached from reality—they are active subjects shaping a culture of peace”.
2. Le savoir comme médiation
Dans un temps de repli identitaire et de conflictualité religieuse, les universités catholiques incarnent la diplomatie de la raison. Elles offrent un cadre où la recherche devient médiation et où la science se fait service de la paix. Leurs enseignants sont, de fait, des diplomates du sens : ils négocient les frontières de l’altérité pour mieux en révéler la fécondité.
3. Un leadership mondial du dialogue
La FIUC, par sa vocation transcontinentale, est l’infrastructure de cette diplomatie académique. Elle relie entre elles plus de deux cents universités réparties sur les cinq continents ; elle encourage les partenariats interreligieux, soutient la recherche conjointe et donne au monde catholique universitaire une voix unifiée dans les débats globaux.
Affirmer aujourd’hui ce leadership intellectuel n’est pas une question d’influence, mais de responsabilité : celle de rappeler, dans un monde fragmenté, que la vérité ne se possède pas — elle se partage.
C’est à cette condition que l’université catholique peut devenir ce que Nostra Aetate pressentait : un lieu où la reconnaissance mutuelle précède la connaissance, et où la connaissance nourrit la paix.
Conclusion : pour une catholicité de la rencontre
Soixante ans après Nostra Aetate, le défi n’est plus seulement de commémorer un texte, mais d’en vivre la dynamique. Le monde de 2025 n’est plus celui du Concile : il est traversé par de nouvelles fractures culturelles, numériques, identitaires. Mais c’est précisément dans ce contexte que l’esprit du Concile retrouve sa pertinence.
Les universités catholiques sont déjà fréquemment, mais plus que jamais doivent devenir des laboratoires d’unité dans la diversité, capables de montrer qu’une identité solide n’est pas une identité fermée. Dans un monde où les discours de haine se diffusent à la vitesse des réseaux sociaux, le dialogue interreligieux n’est pas un supplément d’âme ; il est une stratégie de civilisation.
La Fédération Internationale des Universités Catholiques porte ici une mission singulière : articuler le patrimoine spirituel du catholicisme et l’universalité du savoir. En fédérant les initiatives, en stimulant la recherche, en incarnant une diplomatie académique du bien commun, la FIUC peut donner à Nostra Aetate un nouvel élan : celui d’une catholicité pensante, dialogale et globale. Ce que Nostra Aetate annonçait sur le plan spirituel, ces universités l’incarnent aujourd’hui sur le plan intellectuel : une mondialisation du sens plutôt qu’une uniformisation des savoirs.
Dr François Mabille, Secrétaire Général de la FIUC











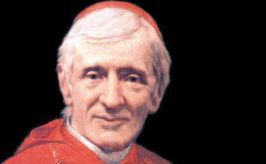

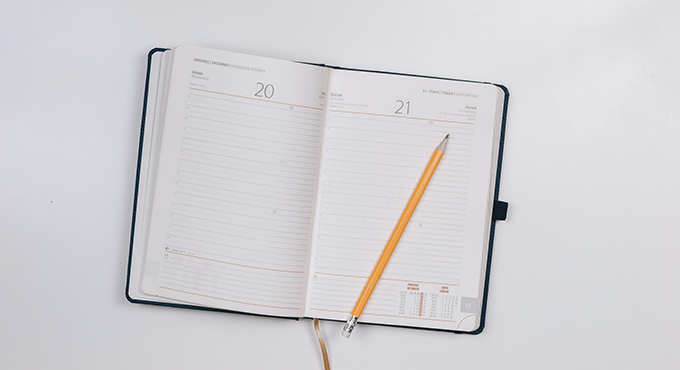
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.