Une revue de la lettre apostolique du Pape Léon XIV Dessiner de nouvelles cartes de l'espérance.
Deux langues coexistent, souvent sans dialogue, dans les universités catholiques aujourd'hui : la langue des classements et de l'accréditation d'une part, et la langue de l'Évangile et de la tradition d'autre part. Le premier exige efficacité, impact mesurable et compétitivité globale. Le second parle de la personne, de la dignité et de la recherche commune de la vérité. Est-il possible de faire dialoguer ces deux langages sans que l'un ne finisse par l'emporter sur l'autre ? Une université catholique peut-elle être académiquement excellente sans trahir son identité, ou sommes-nous condamnés à choisir entre la qualité scientifique et la fidélité évangélique ?
La publication de la lettre apostolique du pape Léon XIV, intitulée "Concevoir de nouvelles cartes de l'espérance", intervient à un moment particulier. Soixante ans après la déclaration Gravissimum educationis, les universités catholiques sont confrontées à des défis que le Concile Vatican II ne pouvait pas prévoir : la fragmentation radicale du savoir, la numérisation accélérée de l'enseignement, la pression mercantiliste sur l'enseignement supérieur, la crise écologique et l'intelligence artificielle. Face à ces défis, il serait compréhensible de se replier sur la nostalgie ou de se diluer dans le pragmatisme. Le Pape propose une troisième voie : la créativité comme fidélité, la tradition comme laboratoire de l'avenir et l'unité comme tâche partagée.
Ce document n'est ni un manuel de bonnes pratiques ni un traité théorique. Il s'agit plutôt d'une invitation à repenser, à partir de la base, ce que signifie être une université catholique au 21e siècle. Quelle anthropologie sous-tend nos programmes d'études et nos formes d'évaluation ? Comment tisser ensemble ce que le temps a fragmenté sans tomber dans des synthèses superficielles ? Comment les universités catholiques peuvent-elles former des "constellations" qui guident dans l'obscurité, plutôt que de rivaliser pour des miettes de prestige ? Comment faire en sorte que la liberté académique ne débouche pas sur l'arbitraire individuel ou le conformisme institutionnel ?
La lettre récupère la mémoire vivante d'une tradition qui, loin d'être un fardeau, est présentée comme une "boussole qui continue à indiquer le chemin" (1.3). L'histoire n'est pas ici une nostalgie, mais une source de sagesse pour comprendre et répondre aux défis du présent. Des Pères du désert à Newman, des premières universités médiévales aux congrégations éducatives modernes, l'Église a su générer des réponses originales à chaque époque. Aujourd'hui, il nous appartient de poursuivre cette tradition créative.
La créativité comme fidélité évangélique
L'un des points les plus provocants de la lettre est sa vision du rôle de la créativité. Le Pape nous rappelle que les communautés éducatives qui se laissent guider par le Christ "ne se retirent pas, mais sont relancées ; elles ne construisent pas de murs, mais des ponts. Elles réagissent avec créativité". (1.1). Cette créativité n'est pas un caprice, ni une innovation formelle, mais une fidélité à l'Évangile qui "ne vieillit pas mais fait toutes choses nouvelles (1.1)".
Pour l'université catholique, cela implique un défi radical : assumer que la créativité n'est pas optionnelle mais constitutive de son identité. Nous ne pouvons pas nous réfugier dans le "on a toujours fait comme ça" (3.1), car cela reviendrait à trahir la tradition même qui nous constitue. L'histoire de l'éducation catholique est précisément l'histoire de réponses originales à des besoins concrets (cf. 2.1).
Pour l'université catholique, cela implique un défi radical : assumer que la créativité n'est pas optionnelle mais constitutive de son identité. Nous ne pouvons pas nous réfugier dans le "on a toujours fait comme ça" (3.1), car cela reviendrait à trahir la tradition même qui nous constitue. L'histoire de l'éducation catholique est précisément l'histoire de réponses originales à des besoins concrets (cf. 2.1).
La dignité, et non les indicateurs, comme critère et objectif
D'autre part, le Pape nous demande que l'éducation ne soit pas mesurée uniquement "en termes d'efficacité : elle est mesurée en termes de dignité, de justice et de capacité à servir le bien commun" (4.2). À l'heure des classements, des mesures d'impact et des évaluations quantitatives, Léon XIV nous ramène au critère fondamental : "la dignité, la justice, la capacité à servir le bien commun" (4.2). Une personne n'est pas "un profil de compétences", elle ne peut être réduite à un algorithme prévisible, mais à un visage, une histoire, une vocation" (4.1).
C'est peut-être l'un des défis les plus urgents pour nos universités. Comment résister à la logique mercantiliste qui réduit l'éducation à "une formation fonctionnelle ou un instrument économique" (4.1) ? Comment cultiver une "formation chrétienne (qui) englobe toute la personne : spirituelle, intellectuelle, affective, sociale, corporelle" (4.2) alors que les systèmes d'accréditation valorisent avant tout la productivité scientifique mesurable ?
La lettre ne propose pas un rejet naïf de l'excellence académique, mais une réorientation de son sens. A la suite de Newman, dont la "vision empathique" est revendiquée (3.1), il s'agit d'éviter "une approche purement mercantiliste" sans renoncer à la rigueur (4.2).
Retisser ce que le temps a fragmenté
Le document nous invite à comprendre la fragmentation de la connaissance comme un problème anthropologique, et pas seulement méthodologique, ce que nous avons déjà beaucoup entendu dans le contexte du Pacte mondial pour l'éducation. Le Pape parle d'une éducation qui ne sépare pas "manuel et théorique, science et humanisme, technique et conscience" (4.2), qui ne veut pas "séparer le désir et le cœur de la conscience : cela signifierait briser la personne" (3.1).
Cette vision holistique requiert, comme le cite François, "l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité exercées comme sagesse et créativité" (7.1). Il ne s'agit pas de juxtaposer des disciplines dans des activités spécifiques, ou dans des unités académiques spécifiques, mais de construire une vision inspirée par la "cosmologie de la paideia chrétienne" (1.2), où l'unité n'est pas imposée de l'extérieur mais découverte de l'intérieur, inspirée par la réalité même de la personne humaine en tant qu'image de Dieu.
Pour l'université catholique, cela signifie repenser radicalement les structures de ses unités et même les modes d'évaluation du travail des universitaires. Comment pouvons-nous créer des espaces où "la foi n'est pas une "matière" supplémentaire, mais le souffle qui oxygène toutes les autres matières" (6.2) ?
Constellations éducatives : une ecclésiologie de service
La métaphore des "constellations éducatives" (1.2, 8.1) est une image très intéressante et potentiellement prolifique de la lettre. Contre la tentation de la rivalité ou de l'isolement, le Pape propose un réseau vivant où "chaque étoile a sa propre luminosité, mais toutes ensemble elles tracent un chemin" (8.1). Les différences "ne sont pas des fardeaux, mais des ressources" (8.2).
Cela implique de passer de la concurrence à la complémentarité, de croire que ma discipline est suffisante à reconnaître que nous avons besoin de ce que l'autre offre, de travailler de manière isolée et confinée dans nos bureaux et nos laboratoires à créer des réseaux de recherche et d'enseignement qui transcendent les frontières institutionnelles et nationales.
Ce modèle est profondément enraciné dans l'Évangile. Les constellations ne sont pas des structures bureaucratiques, mais des corps vivants nés de la rencontre avec le Christ. Comme les premières communautés chrétiennes ont généré "des expériences à la fois humbles et fortes, capables de lire les temps" (1.2), nous sommes aujourd'hui invités à collaborer en dépassant les rivalités pour montrer que "l'unité est notre force la plus prophétique" (8.1).
Pour les universités catholiques, cela implique de passer de la concurrence à la complémentarité, de croire que ma discipline est suffisante à reconnaître que nous avons besoin de ce que l'autre offre, de travailler isolément et enfermés dans nos bureaux et nos laboratoires à créer des réseaux de recherche et d'enseignement qui transcendent les frontières institutionnelles et nationales (8.2). Il est intéressant de voir comment la proposition fait allusion à une réflexion sur un modèle ecclésial véritablement synodal au cœur de l'université catholique.
L'anthropologie, une responsabilité partagée
La lettre pose l'un de ses défis les plus complexes lorsqu'elle affirme qu'une réflexion anthropologique doit être "à la base d'un style éducatif" (7.1), et qu'elle ne peut être déléguée exclusivement à une seule discipline. En ce sens, le Pape demande que la "question du rapport entre foi et raison" ne soit pas un "chapitre optionnel" (3.1) et, citant Newman, il rappelle une vérité souvent oubliée mais essentielle pour l'université : "la vérité religieuse n'est pas seulement une partie, mais une condition de la connaissance générale" (3.1).
Cela signifie que l'ensemble de la communauté universitaire, des acteurs de la construction civile à ceux de la théologie, des étudiants aux administrateurs, doit participer à cette réflexion sur ce qu'est l'être humain. Non pas comme un ajout pieux et isolé à un moment ou à un lieu de l'université, mais comme la condition de tout son travail. L'anthropologie chrétienne, qui voit la personne comme l'image de Dieu (3.1), n'est pas un présupposé facultatif, mais une ouverture à la vérité intégrale de l'homme et, par conséquent, essentielle pour nous tous qui habitons l'université.
Cette réflexion partagée requiert, comme le souligne le document, "un cœur qui écoute, un regard qui encourage, une intelligence qui discerne" (5.2). En d'autres termes, il s'agit d'une mission qui implique un modèle particulier d'université où la personne n'est pas fragmentée en rôles - étudiant, universitaire, chercheur, administratif, etc. - mais est reconnue comme un tout vivant: avec ses questions existentielles, sa quête de sens, ses fragilités et ses aspirations. Cela exige que l'université catholique soit plus qu'un espace de transmission de connaissances spécialisées : elle doit devenir une authentique "communauté éducative" (3.1), un nous où tous participent à la réflexion sur ce que signifie être humain à notre époque. Il ne suffit pas que des théologiens ou des philosophes réfléchissent à l'anthropologie pendant que d'autres font leur propre travail. La question de l'être humain traverse toutes les recherches, tous les enseignements, toutes les décisions institutionnelles.
Cela signifie concrètement que l'ingénieur qui enseigne le calcul accompagne les personnes en formation ; que le biologiste qui fait des recherches sur la génétique ne peut se soustraire aux questions éthiques que son travail soulève ; que l'économiste ne peut séparer l'efficacité de la justice. Comme l'insiste la lettre, "il ne faut pas séparer le désir et le cœur du savoir : ce serait briser la personne" (3.1). La spécialisation, nécessaire et précieuse, ne doit pas nous faire oublier que nous formons des personnes dont le "professionnalisme est imprégné d'éthique" (4.2), pour qui la technique ou la compétence doit être au service de la dignité humaine. Ce n'est qu'à partir de cette compréhension profonde de l'être humain que l'on peut discerner quel savoir vaut la peine d'être transmis et dans quel but. Ce modèle holistique contraste radicalement avec l'université fonctionnelle qui forme sur la base de "profils de compétences" pour le marché du travail. Planifier et aller dans cette direction n'est pas un ajout à une véritable éducation, mais sa condition de possibilité.
Élargir l'accès à l'éducation, une question d'identité
La lettre insiste sur le fait qu'éduquer, c'est "placer la personne au centre" (5.1), en reconnaissant sa "dignité inaliénable" (5.1). Mais cette centralité n'est pas rhétorique : elle se traduit par des politiques concrètes que l'université catholique doit assumer sans ambiguïté. Garantir l'accès aux plus pauvres, soutenir les familles fragiles et promouvoir les bourses d'études (10.4). Ce sont des impératifs, pas des options. Le Pape est catégorique : "perdre les pauvres" équivaut à perdre l'école elle-même (10.4). Une université qui ferme ses portes pour des raisons économiques a perdu son identité catholique, quels que soient les symboles extérieurs qu'elle conserve. Car "la gratuité évangélique n'est pas une rhétorique : c'est un style de relation, une méthode et un objectif" (10.4).
La liberté académique en tant que recherche commune de la vérité
"La vérité est recherchée dans la communauté" et "la liberté n'est pas un caprice mais une réponse" (4.3). Cela implique de comprendre que l'université catholique est le lieu "où les questions ne sont pas réduites au silence et où le doute n'est pas interdit mais accompagné" (3.1). C'est donc une compréhension profonde et parfois oubliée de la liberté académique, que de la comprendre non pas comme un choix individuel mais comme une quête commune.
Derrière ce modèle, l'éducation se présente comme un acte d'espérance en l'être humain et comme un acte d'amour et de solidarité : "Tout être humain est capable de vérité, mais le chemin est beaucoup plus supportable quand on avance avec l'aide des autres" (3.2). On découvre ainsi que la vérité ne s'impose pas, mais qu'elle se découvre dans le dialogue, dans le contraste des perspectives, dans la patience du discernement.
Cela protège l'université catholique à la fois de l'autoritarisme dogmatique et du relativisme sceptique. Il ne s'agit pas de "brandir l'étendard de la possession de la vérité" (4.3), mais de maintenir la confiance dans le fait que la vérité existe et peut être connue, toujours imparfaitement et toujours en chemin.
L'histoire nous apprend que chaque époque a nécessité de l'audace : des moines qui ont préservé la culture classique aux premières universités nées "du cœur de l'Eglise" (2.2), en passant par Calasanz qui ouvre des écoles gratuites ou Don Bosco qui invente sa méthode préventive.
Aujourd'hui, cette audace signifie poser des questions sur la signification de l'intelligence artificielle ou de la justice écologique (7.2), sur les nouvelles formes d'apprentissage dans les environnements numériques (9.1-9.3). Cela signifie oser remettre en question des structures qui ont pu fonctionner dans le passé, mais qui ne répondent plus aux besoins d'aujourd'hui.
La lettre invite les universités catholiques à être "des laboratoires de discernement, d'innovation pédagogique et de témoignage prophétique" (11.1). Cela demande du courage intellectuel et de la liberté intérieure. Comme le dit le pape en citant saint Augustin, "notre présent est une intuition, un temps que nous vivons et dont nous devons profiter avant qu'il ne nous échappe" (11.2).
La tradition comme transmission vivante
Le document rappelle que "l'éducation est un travail d'amour transmis de génération en génération" (3.2). La tradition n'est pas une répétition mécanique, un copier-coller de concepts, de formulations ou de coutumes. C'est une mémoire active et non une archive monolithique.
Cette compréhension dynamique est essentielle pour l'identité catholique, car il ne s'agit pas de conserver des formules, des méthodes, des concepts ou des termes, mais de maintenir vivant le feu de l'Esprit (2.1). Les charismes éducatifs "ne sont pas des formules rigides : ils sont des réponses originales aux besoins des temps" (2.1), ce qui implique de les comprendre comme une tâche exigeant discernement et flexibilité.
La lettre du pape Léon XIV nous ramène à l'essentiel : soit l'anthropologie chrétienne articule et imprègne tout notre travail universitaire, soit nous finirons par devenir des institutions efficaces mais évangéliquement vides.
Naviguer avec espoir
La lettre Concevoir de nouvelles cartes de l'espérance n'est pas un document de nostalgie mais d'espérance active. C'est une invitation : "désarmez vos paroles, levez les yeux, gardez votre cœur" (11.2). Ce n'est pas un appel à la passivité contemplative, mais à l'action née du discernement. Désarmer n'est pas se rendre ; c'est reconnaître que la vérité ne peut être conquise par la violence - pas même par la violence dialectique. Lever les yeux n'est pas se soustraire à la réalité, mais se rappeler, comme Abraham, que les étoiles promettent la fécondité même dans la stérilité du présent. Garder le cœur, ce n'est pas s'enfermer, c'est protéger le feu qui est déjà en nous et qui nous permet d'accueillir et d'abriter l'autre.
L'université catholique se trouve à un carrefour qui est, au fond, théologique : avons-nous vraiment confiance que la vérité peut être connue par l'être humain en communauté, ou avons-nous secrètement cédé au relativisme fonctionnel qui ne mesure que l'impact et les classements ? Croyons-nous vraiment que la personne est l'image même de Dieu, ou finissons-nous par réduire notre praxis éducative à la formation de "profils de compétence" ? La lettre du Pape Léon XIV nous ramène à l'essentiel : ou bien l'anthropologie chrétienne articule et imprègne tout notre travail universitaire, ou bien nous finirons par être des institutions efficaces mais évangéliquement vides.
Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un modèle pédagogique, mais la possibilité même d'espaces où la raison et la foi se rencontrent sans violence, où la liberté académique ne dégénère pas en arbitraire individualiste ou en relativisme confortable, où la recherche de l'excellence ne trahit pas le service aux plus pauvres. Cette possibilité n'est pas garantie, mais c'est une tâche. Comme nous le rappelle la lettre, "chaque génération est responsable de l'Évangile" (1.1), et nous sommes cette génération !
Serons-nous capables d'imaginer de nouvelles formes de communautés universitaires où le mot "intégral" n'est pas un slogan mais une expérience vécue ? Serons-nous capables de construire des constellations qui guident plutôt que de rivaliser pour le prestige ? Oui, mais seulement si nous renonçons à l'illusion de posséder la vérité sans cesser de la chercher passionnément, seulement si nous comprenons que la tradition n'est pas un lest mais une voile déployée, seulement si nous reconnaissons que la créativité la plus audacieuse est, paradoxalement, la fidélité la plus profonde à l'Évangile.
Fernando SOLER
Faculté de théologie, Pontificia Universidad Católica de Chile
Secrétaire de la Conférence des institutions catholiques de Théologie (FIUC - CICT-COCTI)
Article original publié dans https://revistadialogos.uc.cl/constelaciones-de-esperanza-el-desafio-de-una-experiencia-integral-en-la-universidad-catolica/












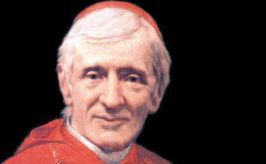

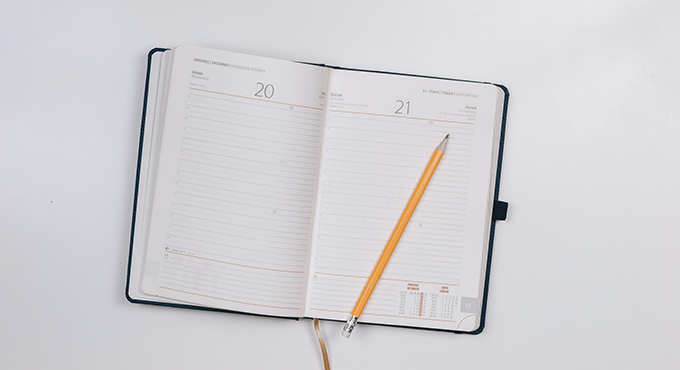
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.