
De la sauvegarde de la création à l’écologie intégrale : la pensée catholique à l’épreuve de l’anthropologie de Philippe Descola
Par Dr François Mabille
Secrétaire général de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC)
Parmi les anthropologues contemporains, Philippe Descola occupe une place singulière. Élève de Claude Lévi-Strauss, professeur au Collège de France, il a profondément renouvelé les sciences sociales en s’attaquant à l’un des piliers de la modernité occidentale : la séparation entre nature et culture. Ses travaux — fondés sur son expérience prolongée auprès des Achuar d’Amazonie puis sur une ambitieuse comparaison des cosmologies humaines — ont installé une idée centrale : les humains n’ont pas partout découpé le monde selon les mêmes évidences. L’opposition qui structure l’Occident moderne depuis le XVIIᵉ siècle, celle d’une nature objective et d’une humanité autonome, n’est ni universelle ni nécessaire.
Dans Par-delà nature et culture, Descola propose ainsi une typologie des « ontologies » -naturalisme, animisme, totémisme, analogisme - qui décrit les grandes manières qu’ont les sociétés humaines de composer un monde. Le naturalisme occidental n’y est qu’un régime parmi d’autres : un dispositif intellectuel qui produit l’idée de nature comme extériorité, d’individus comme unités autonomes, et d’une humanité définie essentiellement par la rupture plus que par la relation. Cette grille de lecture ne fournit pas seulement un outillage anthropologique ; elle ouvre un espace théorique et spirituel pour penser différemment notre place dans le cosmos. En dévoilant la contingence du naturalisme, Descola rend à nouveau pensable une vision du monde où la relation prime sur l’objectivation, où les êtres se définissent par les liens qu’ils tissent, où la matière elle-même est porteuse de sens.
Autrement dit : il offre aux traditions religieuses - et singulièrement à la tradition catholique - la possibilité de relire leurs héritages à nouveaux frais, en assumant pleinement ce que l’on pourrait appeler une ontologie de la relation.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la réflexion catholique contemporaine sur l’écologie. Loin d’être un simple prolongement moral ou environnemental, elle touche au cœur même de notre manière de comprendre la création. La notion d’écologie intégrale, promue par Laudato Si’ puis approfondie sous le pontificat de Léon XIV, rejoint de nombreux aspects de l’analyse de Descola : refus du dualisme nature/culture, attention au tissu relationnel du vivant, reconnaissance de la fragilité comme dimension constitutive de nos existences.
Loin de toute récupération superficielle, mobiliser Descola permet donc de donner une légitimité intellectuelle solide à l’effort théologique en cours : démontrer que la vision catholique de la création n’est pas une réaction à la modernité, mais une réponse structurée à ses impensés. Rappeler l’apport de Descola, c’est ainsi affirmer la pertinence de la pensée catholique dans le débat contemporain. Son anthropologie éclaire, par contraste, ce que l’Église propose aujourd’hui : non une spiritualité de la nature, ni une technocratie verte, mais une anthropologie relationnelle, profondément enracinée dans l’analogisme chrétien, où chaque être créé est signe, médiation et appel à la responsabilité.
C’est sur cette base que s’inscrit l’analyse proposée dans les pages qui suivent et qui n’a d’autre ambition que de favoriser une discussion entre approches intellectuelles différentes mais qui peuvent être fécondes: une lecture croisée de l’évolution de la pensée catholique de la création et de la grille anthropologique de Philippe Descola, pour montrer comment l’Église contribue aujourd’hui à une recomposition du visible fidèle à sa tradition et pertinente pour le monde contemporain.
Les prémices d’une conscience écologique chrétienne
La prise de conscience écologique dans le monde chrétien ne date pas de l’encyclique Laudato Si’. Dès les années 1980-1990, un ensemble de minorités actives au sein du christianisme européen commençait à faire émerger une théologie de la création renouvelée.
Le Rassemblement œcuménique de Bâle (1989) fut l’un de ces moments fondateurs : les Églises d’Europe y affirmèrent que la justice, la paix et la sauvegarde de la création constituaient trois dimensions inséparables de la foi et de la mission chrétienne. Ce triptyque, qui inspirera plus tard le concept de “développement humain intégral”, liait déjà la conversion écologique à la conversion sociale et spirituelle.
Dans les années qui suivirent, des mouvements comme Pax Christi jouèrent un rôle essentiel dans la diffusion de cette sensibilité. Loin de réduire l’écologie à un discours environnemental, ils l’enracinèrent dans une anthropologie chrétienne du lien, insistant sur la dignité de toute vie, la non-violence et la solidarité cosmique. Le thème de la “souffrance de la création” fit alors son apparition dans les messages pontificaux pour la Journée mondiale de la paix, en particulier sous Jean-Paul II (Paix avec Dieu, paix avec toute la création, 1990) et Benoît XVI [1] (Si tu veux construire la paix, protège la création, 2010). Ces textes invitaient à relire la domination humaine sur la nature à la lumière de la Genèse non comme un mandat d’exploitation, mais comme une vocation à la responsabilité.
Cette évolution préparait déjà une mutation ontologique : le passage d’une conception dualiste - l’homme et la nature - à une vision relationnelle de la création. C’est cette bascule que Philippe Descola, dans son œuvre, décrit comme un déplacement hors du naturalisme moderne.
Laudato Si’ ou la réhabilitation analogiste du monde
En 2015, avec l’encyclique Laudato Si’, le pape François a inscrit de manière décisive la réflexion catholique dans une perspective que l’on peut, à la lumière de Descola, qualifier d’analogiste. L’encyclique ne se contente pas de rappeler la nécessité d’une conversion écologique ; elle propose une ontologie du lien, fondée sur l’idée que “tout est lié”. Chaque être, chaque créature, chaque écosystème est porteur d’une dignité propre et participe à une harmonie voulue par Dieu.
Selon la grille de Descola, l’analogisme se définit par un monde discontinu mais relié, où les différences entre les êtres ne sont pas abolies mais intégrées dans un réseau de correspondances. Laudato Si’ relève précisément de ce régime : la création n’est pas un tout homogène, mais un ensemble différencié d’entités reliées entre elles par l’amour divin.
Le monde y est décrit comme un tissu de relations sacramentelles, où le visible renvoie sans cesse à l’invisible. Le cosmos n’est plus une nature à maîtriser, mais une communion à contempler et à servir.
François opère ainsi une réconciliation entre science et foi, entre raison et spiritualité. Il assume l’héritage naturaliste de l’Occident (la confiance dans la recherche, le dialogue avec l’écologie scientifique) tout en le dépassant par une anthropologie de la relation et de la responsabilité.
Le naturalisme est conservé comme méthode, mais subverti comme cosmologie : la nature cesse d’être objet pour redevenir signe. Dans le langage de Descola, Laudato Si’ marque la tentative d’un retour analogiste au sein même du monde naturaliste : une réintroduction du symbolique, de la correspondance et du sens dans un univers perçu jusqu’alors comme pure matérialité.
Le monde comme tissu de relations sacramentelles
L’expression désigne une vision du monde où chaque être créé existe par et pour la relation. Dans la perspective de Laudato Si’, la création n’est pas un ensemble d’objets mais un réseau de relations vivantes, dont chacune peut devenir médiation de la présence divine. Le monde est ainsi “sacramentel” : il rend visible l’invisible, il manifeste la grâce dans la matière. Cette intuition rejoint, sur le plan anthropologique, ce que Philippe Descola nomme l’ontologie analogiste : un cosmos où les réalités discontinues – Dieu, l’homme, les créatures – sont reliées par des correspondances. La théologie chrétienne en donne une version singulière : ces correspondances ne sont pas seulement symboliques. L’eau du baptême, le pain eucharistique ou la fraternité cosmique ne sacralisent pas la nature ; ils reconnaissent dans le lien même – entre visible et invisible, matière et esprit – l’action continue du Créateur.
Léon XIV : de l’écologie intégrale à l’écologie christocentrique
L’élection du pape Léon XIV a prolongé cette ligne, tout en lui donnant un accent théologique plus explicite. Ses prises de position récentes - notamment dans son message pour la Journée mondiale de prière pour la création 2025 et dans ses discours sur le climat - prolongent l’héritage de Francois en y ajoutant une dimension christologique plus tranchée.
Léon XIV affirme, dans la continuité de François, que “la nature ne doit pas être réduite à une marchandise”, et appelle à une conversion intérieure fondée sur la sobriété et la justice environnementale. Ses initiatives concrètes, telles que la création du centre d’éducation écologique “Borgo « Laudato Si »” [2] ou l’institution d’une liturgie pour le soin de la création, traduisent cette volonté d’incarner la conversion écologique dans la vie quotidienne de l’Église. Mais il a également apporté une clarification doctrinale majeure par rapport aux dérives possibles d’un discours « écospirituel » excessif, dénonçant “une nouvelle tentation de Babel”, celle de “vouloir sauver la création sans passer par le Sauveur”.
Cette critique n’est pas un repli conservateur : elle s’inscrit dans une purification théologique du discours écologique. En rappelant que la création n’est pas divine mais sacramentelle, Léon XIV redéfinit le juste équilibre entre reconnaissance du monde comme signe de Dieu et refus de toute divinisation du cosmos. Là où François avait ouvert le champ d’une fraternité cosmique, Léon en souligne la frontière : le monde conduit à Dieu, il ne le remplace pas. Autrement dit, Léon XIV assume l’analogisme de François, mais en écarte le risque animiste.
Les créatures sont des signes de la présence divine, non des sujets divins.
Leur beauté et leur fragilité appellent l’adoration du Créateur, non la vénération de la création elle-même. Ainsi, sa critique de “l’idolâtrie écologiste” ne rejette pas l’écologie intégrale, mais en rétablit la hiérarchie théologique : la sauvegarde de la création relève de la rédemption, non d’un salut naturel ou auto-produit.
L’apport de Descola : une clé de lecture anthropologique
La typologie des ontologies proposée par Descola — animisme, naturalisme, totémisme, analogisme — permet de comprendre le positionnement proprement catholique dans le débat écologique contemporain. La théologie de la création chrétienne relève, dans son fond, d’un analogisme théologique : Dieu est à la fois transcendant et immanent, et la création est une suite de médiations entre ces deux pôles. Le monde devient ainsi espace de médiations ascendantes, où la grâce circule du visible à l’invisible. L’“analogisme” de Descola trouve ici sa contrepartie théologique : un cosmos différencié mais relié, ordonné non par des forces impersonnelles, mais par la participation de l’être créé à l’Être divin. Ce modèle analogiste explique la capacité du christianisme à dialoguer avec la science (héritage naturaliste), à reconnaître la fraternité cosmique (accents animistes), tout en conservant la verticalité de la transcendance. Descola offre ici une grille d’interprétation féconde pour dépasser les polarisations entre rationalisme technologique et « écospiritualité » diffuse.
Vers une théologie de la relation
L’enjeu de l’époque, que François puis Léon XIV affrontent chacun à leur manière, est de refonder la relation entre Dieu, l’homme et le monde. Le christianisme, sans se confondre avec une cosmologie autochtone, retrouve dans cette réflexion anthropologique les ressources d’une pensée du lien, que l’humanisme moderne avait partiellement oubliées. À travers la notion d’écologie intégrale, l’Église catholique réinscrit sa mission dans une anthropologie du monde habité, où la responsabilité morale devient la forme contemporaine de la sainteté. Ce tournant ouvre une voie médiane ni naturaliste (le monde comme objet), ni animiste (le monde comme sujet divin), mais analogiste (le monde comme signe et relation).
Conclusion : la recomposition catholique du visible
L’évolution de la pensée catholique de l’écologie, de Bâle à Léon XIV, révèle une transformation profonde : l’Église est passée d’une morale environnementale à une ontologie de la relation. Cette mutation, que l’on peut éclairer par Descola, traduit une volonté d’habiter le monde autrement — non plus en propriétaire, mais en « intendant » du mystère. Par-là, le catholicisme offre à la modernité naturaliste une alternative crédible :
un monde où le visible renvoie au spirituel, où la raison scientifique coexiste avec la contemplation, et où l’écologie devient une voie de salut. François en a posé les fondements, Léon XIV en assure la cohérence théologique : l’un a ouvert l’horizon d’une fraternité cosmique, l’autre en rappelle la source christologique. Ainsi, la pensée catholique contemporaine rejoint, par des chemins théologiques, ce que Descola appelle la composition des mondes : un effort constant pour tisser ensemble le sens, la matière et la relation, autrement dit, pour réenchanter le visible sans l’idolâtrer.













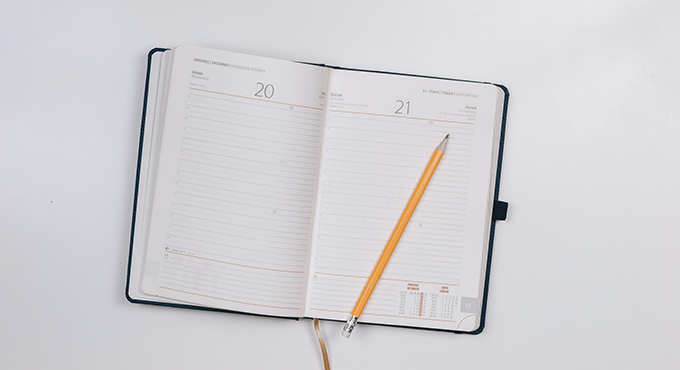
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.